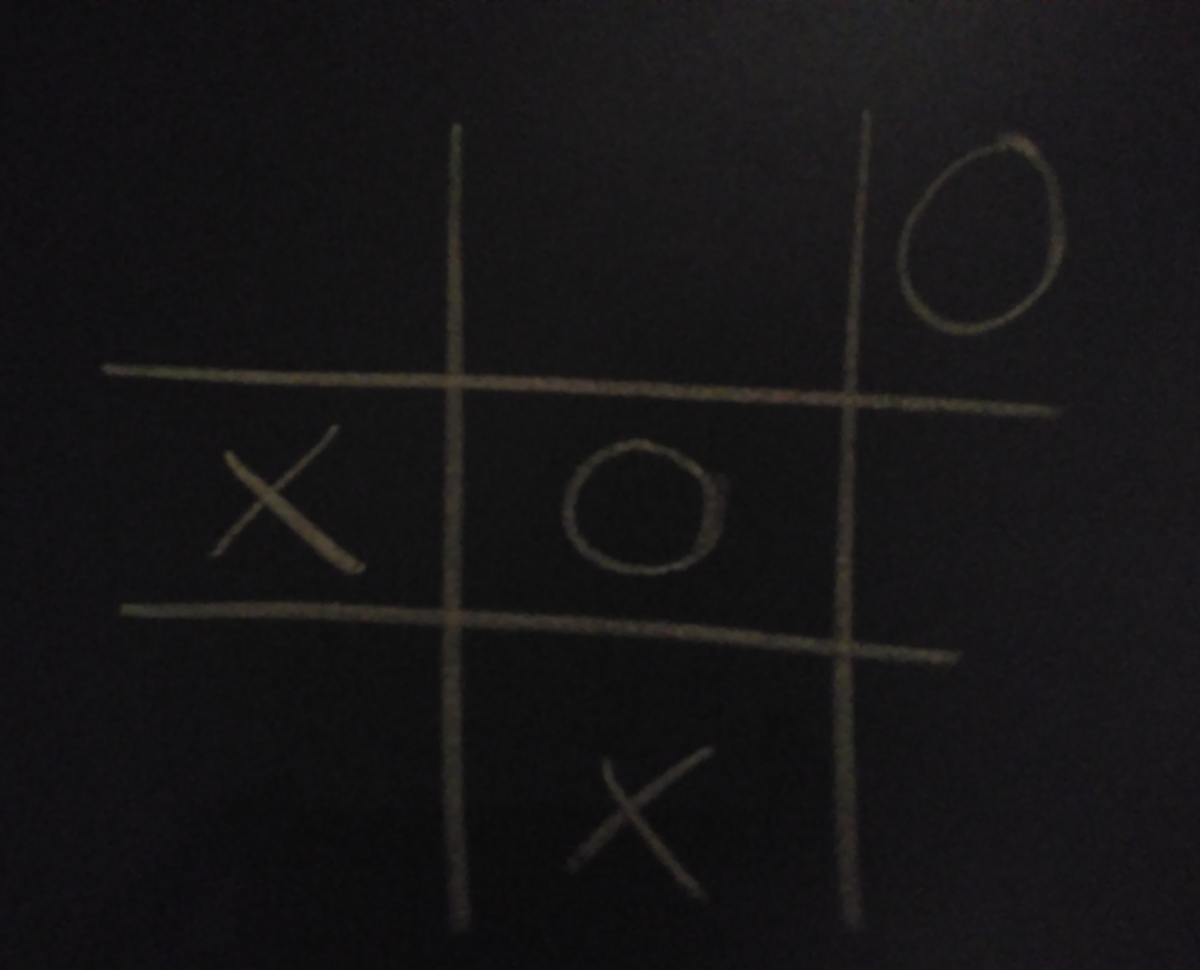
Agrandissement : Illustration 1
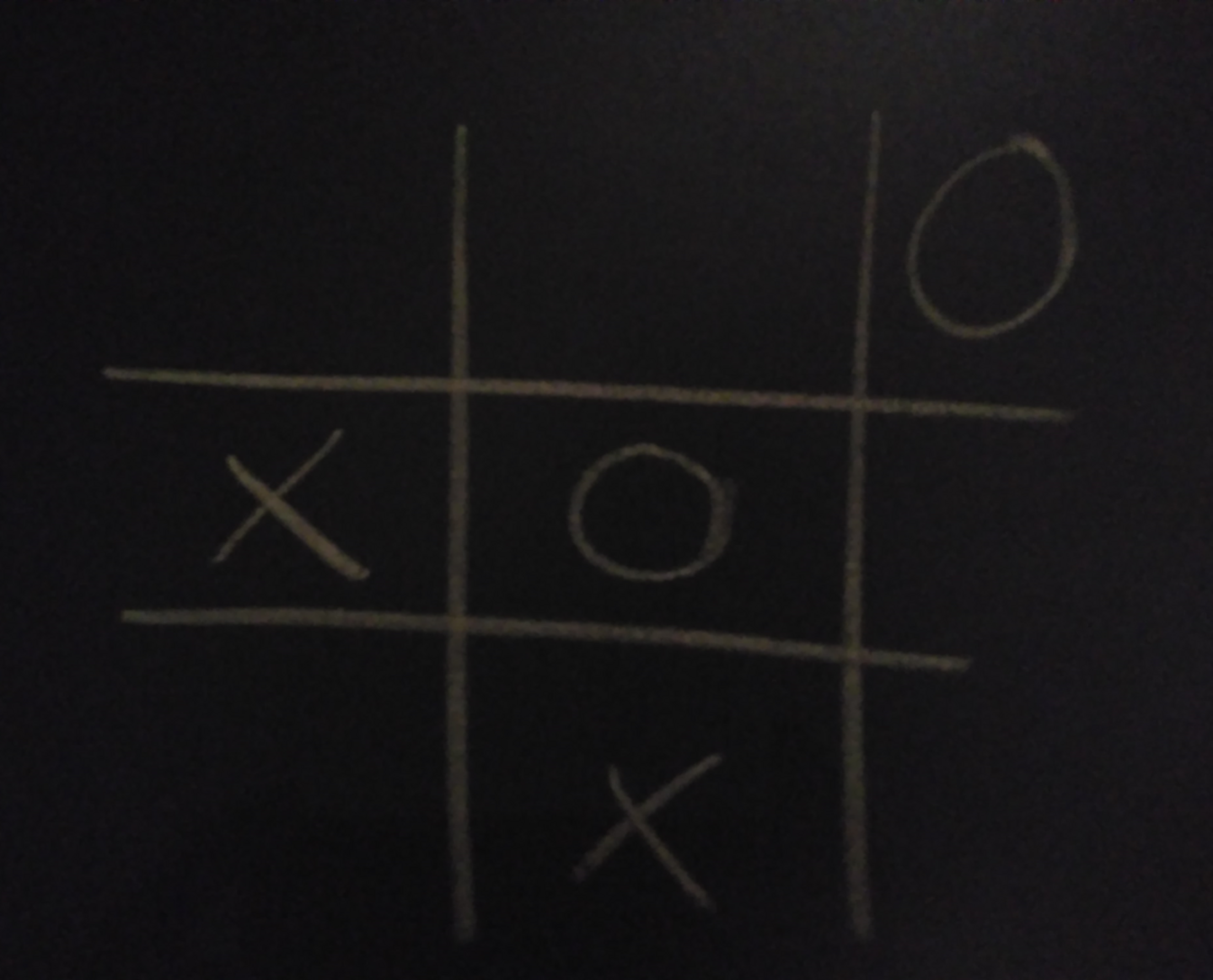
On a largement oublié aujourd’hui que l’enseignement mutuel est une invention relativement récente et que son histoire est indissociable de celle d’une des premières technologies éducatives, le tableau noir. Ainsi, en France, le règlement modèle du 17 août 1851 (articles 10 et 11) stipule que « il y aura dans l’école, au moins un tableau noir destiné à des exercices d’écriture, d’orthographe, de calcul et de dessin linéaire » [1]. On a également oublié les travaux des chercheurs de l’époque qui ont tenté de faire la démonstration de l’impact du tableau noir sur les apprentissages et la pertinence de doter chaque enseignant d’une technologie permettant d’écrire et d’effacer à l’envi des textes donnés à lire ou recopier. Les nombreuses monographies qui se sont appliquées à en décrire les usages ont été vivement critiquées en raison de leur caractère spécifique dont les conclusions apparaissaient difficile à généraliser. Des appels à plus de scientificité ont été lancés par les décideurs politiques qui désiraient disposer de résultats indiscutables démontrant l’impact pédagogique de ces outils couteux avant d’investir massivement et d’équiper chaque classe. Citons par exemple l’étude conduite par Banquarti et ses collaborateurs[2] qui, menée auprès d’un échantillon de 6057 élèves, ne permet pas de constater de différence significative de performance entre les élèves de classes équipées de tableaux noirs et ceux de classes qui en sont dépourvues sauf peut-être un léger gain en éducation physique et en travaux manuels. Les outils d’analyse ont depuis été raffinés et de nombreux travaux se sont attachés à comparer l’influence du tableau noir sur les apprentissages en comparant des classes ayant adopté cette technologie et des classes ayant conservé un enseignement traditionnel. Dans leur méta-analyse de 170 études, les chercheurs David Nah et Nike Vero furent amener à conclure : « the studies did not indicate significant différences in group test scores between blackboard and paper classrooms »[3]. Dès lors, des financements importants furent débloqués pour analyser l’impact du tableau noir sur le fonctionnement cérébral des élèves mais au XIXème siècle, l’encéphalographie n’avait pas été inventée et le projet fit long feu. On peut de toute manière suspecter que des critiques n’auraient pas manqué de souligner que le fait de demander à des élèves de travailler en position allongée et de porter des électrodes changeait quelque peu le déroulement de la classe et par là même, le contexte des apprentissages étudiés. Il faut également rappeler que les études ultérieures qui se sont appuyées sur les méthodologies issues des neurosciences et qui ont failli à démontrer l’impact positif du tableau noir ont imputé cet échec au manque de compétences des enseignants. Au cours des expérimentations, ces derniers s’étaient montrés souvent incapables d’utiliser le potentiel pédagogique de cette technologie par manque de formation ou, plus simplement, d’enthousiasme à l'intégrer à leurs pratiques. C’est donc en absence de toute preuve formelle de plus-value pédagogique que l’usage du tableau noir fut rendu obligatoire en France par la loi du 19 juillet 1889.
Cette fable vient à peine caricaturer les débats autour des méthodologies de recherche sur les technologies numériques et plus particulièrement sur les arguments en faveur de l'introduction des jeux numériques dans l’enseignement. Elle vient souligner l’incongruité de poser la question de l’impact d’une technologie éducative sans prendre en compte la question des modalités de son usage.
En premier lieu, ces débats tendent à nier la complexité de ce qu’est l’acte d’enseigner en proposant d’importer, dans le champ de l’éducation, des méthodes comparatistes qui ne peuvent s’appliquer que sur des situations épurées dont le chercheur peut, sinon les contrôler totalement, a minima caractériser les variables en jeu. Une situation de classe est par essence complexe, non déterministe et non reproductible. Dès lors, comment établir un « groupe contrôle » à l’aune duquel sera évalué l’effet d’un jeu introduit dans le « groupe expérimental » ? Les méthodes comparatistes sont des méthodes de laboratoire et s’il n’est pas exclu de les employer pour étudier les effets d’un jeu, cela ne peut se faire qu’en traitant une question précise dans le cadre de situations épurées qui ont peu à voir avec un contexte de classe et qui, de ce fait ont une portée limtée.
En second lieu, nombre de travaux de recherche qui abordent la question des effets du jeu sur l’apprentissage occultent une question clef : les apprenants étudiés ont été amenés à utiliser un jeu mais ont-ils véritablement joué ? Le jeu est en effet performatif et consubstantiel à son joueur. Enjoindre à un élève de jouer ne garantit pas que ce dernier jouera car on ne joue pas sous la contrainte. La mise en place d’une situation vécue comme ludique dépend avant tout du joueur lui-même et de son attitude ludique. Attitude qui pourra être favorisée par les conditions mises en place par l’enseignant (dont le choix du jeu) mais en aucun cas obtenue sous l’injonction de jouer. Dès lors, il n’est pas certain que tous les travaux de recherche qui aujourd’hui se prétendent des études sur les jeux numériques soient des travaux qui étudient véritablement le jeu car rares sont les papiers qui, en préalable à l’analyse des effets éducatifs du jeu posent la question « les sujets de l’étude ont-ils véritablement joué ? ».
En dernier lieu, les travaux sur les jeux en particulier et sur les technologies éducatives en général sont très souvent empreints d’une conception pour le moins discutable des rapports qui se nouent entre les outils et leurs usagers. Les jeux numériques auraient un « impact » sur le joueur. Autrement dit, du fait de son introduction dans la classe, la technologie (le jeu-game) laisserait sa marque sur un apprenant à l’instar d’une météorite laissant son empreinte sur le sol qu’elle a percuté. Cette manière de voir nie largement les connaissances aujourd’hui bien établies sur les usages des technologies et sur la manière dont ces usages permettent d’apprendre. Jouer à un jeu c’est le mettre à sa main, en imaginer les possibilités, élaborer des stratégies et développer un gameplay spécifique. En retour, cet usage se traduit par des modifications des schèmes d’action et de pensée. Autrement dit, on apprend d’un jeu en se l’appropriant, et, ce faisant, en élaborant un instrument, c’est-à-dire un objet composite qui incorpore un artefact (le jeu-game) et les schèmes d’usages du joueur (le gameplay). Considérer le jeu-game comme une technologie susceptible d’avoir un impact sur un joueur c’est nier le caractère performatif du jeu-play.
Pour étudier les effets d’une technologie éducative, tableau noir ou jeu numérique, il ne suffit pas de mesurer les prétendues conséquences de sa présence dans le système didactique. Il est nécessaire d’en caractériser les usages pour comprendre les relations qui s’établissent entre ces usages et le processus d’apprentissage. Cela suppose que le chercheur aille dans les classes et travaille avec les enseignants pour décrire, voire imaginer, les usages des technologies qu’il sera amené à étudier et recueillir des données qui permettent de mettre en évidence ces relations.
[1] Buisson, F. (1887) Nouveau dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire. Article « Matériel d’enseignement » 1911 ed. Lyon : Institut français de l’éducation. Consultable à l’adresse http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3141
[2] Banquarti, M (1875) Impact du tableau noir à l’école. Paris : Craies et Pédagogies.
[3] Nah, D., Vero, N. (1881) A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of blackboard on learning. Blackboard & Instruction, 45(4), 624–634.



